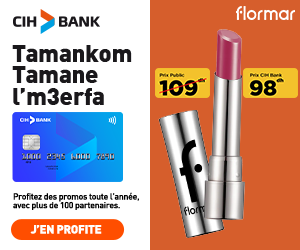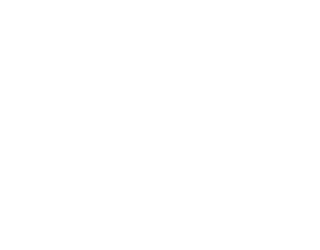Abdelatif Ouahbi, ministre de la Justice, a déclaré que le ministère a réagi aux amendements proposés par les députés, lesquels ont pour but de renforcer le contenu du projet de loi relatif au code de procédure pénale, avec un total de 1384 amendements, dont une partie importante a été accueillie positivement. Il a cependant souligné que d’autres propositions n’ont pas été acceptées, notamment celles liées à des suggestions de formulation ou des modifications de fond en contradiction avec les principes fondamentaux sur lesquels se fonde le texte.
Lors de la présentation du projet de loi n° 03.23 modifiant et complétant la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale devant le Conseil des députés lors d’une session législative, Ouahbi a expliqué que cela concerne tant les référentiels de réforme que de pures justifications techniques ou juridiques, ainsi que les ressources humaines et matérielles importantes nécessaires pour mettre en œuvre certaines d’entre elles.
Le ministre a souligné que son ministère a veillé, depuis le début de la discussion de ce projet au sein de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme, à prendre en compte toutes les observations et propositions voulues, afin de développer une vision globale et intégrée pour faire évoluer le système procédural national, visant à atteindre une formulation qui réalise les objectifs et les finalités de l’élaboration de ce projet, selon les théories modernes des systèmes pénaux procéduraux adoptées par la plupart des législations comparées.
Le ministre a également indiqué que les amendements proposés aux articles du projet de loi ont effectivement contribué à améliorer le texte pour l’adapter aux évolutions en cours et établir une justice procédurale efficace, visant à surmonter les problématiques soulevées par la pratique dans de nombreuses procédures qui ont prouvé leur inefficacité dans la réalisation de la justice pénale et leur insuffisance dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.
Il a ensuite précisé que les principales modifications ayant reçu l’aval du ministère et validées par la commission se manifestent par la reformulation de certaines déclarations afin d’améliorer le texte et d’assurer l’harmonie avec les autres dispositions contenues dans le projet, en plus du renforcement de la protection des victimes de la traite des êtres humains par l’introduction de mesures visant à garantir leur sécurité et à leur fournir les services nécessaires, y compris les aides médicales et psychologiques requises, l’hébergement et l’information sur leurs droits légaux, ainsi que leur droit à demander une indemnisation pour les dommages subis.
Il a souligné que les victimes de la traite des êtres humains bénéficieront d’un délai pour se remettre et réfléchir, conformément aux obligations internationales du Royaume en ce sens, tout en stipulant la nécessité de respecter les garanties légales pendant le déroulement des enquêtes.
Le ministre de la Justice a également évoqué l’introduction de dispositions additionnelles visant à renforcer les droits de la défense durant la phase d’instruction, ainsi qu’à favoriser l’utilisation des technologies modernes dans les diverses procédures juridiques, notant l’interdiction de la présence du ministère public lors des délibérations du tribunal, ainsi que la possibilité de rétablissement concernant la peine d’amende, dès son paiement, et a précisé qu’il ne doit pas être tenu compte du silence comme d’un aveu implicite des faits reprochés à la personne placée en garde à vue.
Ouahbi a souligné que cette initiative législative représente sans aucun doute une étape importante pour moderniser l’arsenal juridique national et répondre aux attentes et aspirations, tout en insistant sur la nécessité de défendre cette loi lors de la prochaine phase de discussion devant le Conseil des conseillers, après l’approbation de la première chambre parlementaire. Il a ajouté : « Nous travaillerons avec responsabilité pour communiquer les dernières actualités concernant ce texte et coordonner avec toutes les parties concernées par la mise en œuvre de ses dispositions, convaincus que la pratique reste le véritable critère de l’application optimale de ses contenus. »
Il a également indiqué que l’importance de la loi sur la procédure pénale croît avec ses ramifications et les liens des domaines qu’elle régit, qui touchent à des domaines aux parcours différents et qui engendrent souvent, lors de la quête de leur atteinte par les intervenants dans le système pénal, des débats et des confrontations juridiques. Cela concerne, d’une part, la nécessité de prouver la commission d’un crime et de juger ses auteurs, et d’autre part, la recherche de l’innocence et les conditions requises pour garantir un procès équitable.
Abdelatif Ouahbi a insisté sur le fait que « l’équation est délicate et nécessite des règles juridiques qui parviennent à établir un équilibre entre la violence de la criminalité et la menace qu’elle fait peser sur la sécurité et la sûreté des citoyens, d’une part, et la protection des droits fondamentaux des individus tels que reconnus par les conventions internationales des droits de l’homme et la Constitution du Royaume, d’autre part. » Et il a ajouté : « Nous ne sommes pas face à une loi ordinaire en termes de son contenu et de ses fonctions ; c’est une véritable constitution pour la justice pénale si l’on peut dire ainsi. Plus les forces de l’ordre sont équipées pour contrer le danger criminel et juger ses auteurs, plus les parties au litige pénal s’appuient sur cette législation pour défendre leurs droits et leurs intérêts ; c’est une pièce de monnaie à deux faces. » Il a poursuivi : « La question de l’élaboration de telles lois représente un moment clé et distinct dans le parcours démocratique des États. »
Le ministre a affirmé que le gouvernement est conscient de « la valeur et de l’importance de ce texte », ajoutant qu’il a suivi les parcours de son élaboration et les raisons des obstacles rencontrés dans les gouvernements précédents. Il a veillé à prendre en compte les discussions qui ont eu lieu à son sujet et à s’efforcer d’ouvrir des débats approfondis avec toutes les parties impliquées et concernées par ses dispositions, qu’il s’agisse d’institutions gouvernementales, judiciaires, sécuritaires ou professionnelles, et a ouvert la consultation à de nombreuses institutions constitutionnelles, telles que le Conseil national des droits de l’homme et le Conseil économique, social et environnemental.
Il a critiqué certaines interprétations du projet depuis sa présentation dans le parcours législatif, jugeant que celles-ci « ont malheureusement parfois eu tendance à refléter un caractère de ‘subjectivité politique’, qui peut être acceptable en raison des différences de référentiels et d’idéologies et des limites de la réforme attendue, mais qui ne l’est pas si elle est exploitée pour entraver l’intérêt général et créer des débats marginaux autour d’une loi qui ne peut être fragmentée entre des intérêts de groupes ou des considérations politiques. »
![]()