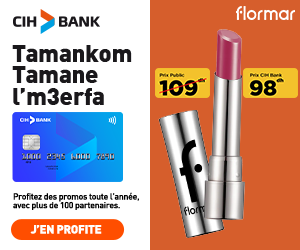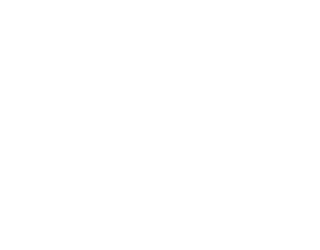Dans le moment où certains pensent que la scène est calme, l’histoire commence à se mouvoir en silence.
Ainsi sont les moments décisifs dans la vie des nations. Ils ne s’accompagnent pas du bruit des canons, ni ne s’annoncent par des discours enflammés, mais commencent comme débute les chapitres majeurs de l’histoire : par un pas mesuré, un geste précis, puis le rideau se lève sur un nouveau chapitre, écrit à l’encre épaisse.
Au Maroc, les contours d’une révolution silencieuse se dévoilent, qui ne brandit pas de drapeaux criards et ne cherche pas à se positionner en première ligne, mais avance — avec prudence et détermination — vers un des dossiers les plus complexes et sensibles : le dossier de la corruption. Cependant, parce que chaque révolution a son propre esprit directif, l’État a choisi de ne pas commencer par les marges ni par les périphéries des institutions, mais par le cœur du pouvoir, là où la justice et le parquet se rejoignent, à un carrefour entre l’État et le droit, entre la responsabilité et la reddition de comptes, entre la justice et l’influence.
Il n’est pas un secret que la justice est le miroir de l’État, et que le parquet — en tant qu’organe de poursuite au nom de la société — est le bras qui tient l’équilibre de la justice. Quand l’État commence sa grande bataille à partir de ces deux autorités, il déclare, sans ambiguïté, que la main qui frappera la corruption doit d’abord être pure, propre et affranchie des résidus du passé et de ses suspicions.
Certains pourraient se tromper en interprétant les enquêtes actuelles touchant plusieurs magistrats comme une campagne saisonnière ou une explosion temporaire. Cependant, en examinant attentivement le timing et les parties impliquées, on aboutit à une seule conclusion : le Maroc entre, avec prudence, dans une ère de règlement des comptes avec les accumulations, non pas par une méthode révolutionnaire qui renverse les institutions, mais selon une méthode réformiste qui les réforme de l’intérieur.
Nous ne sommes pas seulement témoins d’un processus de purification, mais du début d’une nouvelle ingénierie d’un État qui cherche à reprendre l’initiative, à redonner de l’importance à la loi, et à lancer, depuis ses institutions souveraines, le signal de départ d’un combat qui ne se mène pas contre des individus, mais contre un système qui a longtemps cohabité avec la corruption, au point qu’il en soit devenu son protecteur et son producteur.
Dans la prochaine phase, la justice aura un rôle qui dépasse celui de rendre des verdicts ou d’interpréter des textes ; elle devra reconstruire la confiance entre l’État et la société. De son côté, le parquet ne doit pas se contenter des dossiers qui lui sont présentés, mais être proactif, agir, et convaincre l’opinion publique qu’il n’est pas un rempart pour les centres de pouvoir, mais le fer de lance dans la lutte pour la purification.
Entre la main purifiée et l’épée qui frappera les réseaux de corruption, l’État devra bien écouter, non seulement les cris de la rue, mais aussi l’appel de la conscience nationale. Car les peuples qui respectent leurs institutions ne le font pas parce qu’ils ont été trompés, mais parce qu’ils ont vu ces institutions se juger elles-mêmes avant de juger les autres.
Enfin, tout véritable réforme commence par une question simple : qui jugera le juge en cas d’erreur ? Qui osera toucher au parquet s’il se conduit mal ? Le Maroc, ayant osé poser la question, répond maintenant par des actes, non par des paroles.
![]()