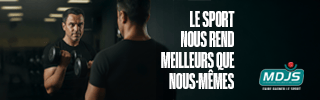Cet article est la réaction de Mohamed Selhami, directeur de Maroc Hebdo, sur l’affaire Hamid El Mahdaoui et la controverse suscitée par la diffusion d’images issues d’une instance interne du Conseil national de la presse. Au-delà du cas individuel, il met en lumière une dérive préoccupante qui interroge la responsabilité journalistique et la protection des institutions professionnelles face aux tentatives de manipulation de l’opinion. Une analyse sans complaisance qui pose une question essentielle : jusqu’où peut aller la liberté d’expression sans basculer dans l’atteinte à l’éthique et à la crédibilité de la presse ?
Il faut appeler les choses par leur nom. Hamid El Mahdaoui n’est pas un journaliste en exercice au sens professionnel et légal du terme. C’est un youtubeur militant et acharné, spécialisé dans la surenchère, la mise en scène et la fabrication du scandale. Et c’est précisément cette confusion entretenue, sciemment, entre journalisme et agitation numérique qui constitue aujourd’hui l’un des dangers les plus sérieux pour l’espace public marocain.
Qu’on cesse l’hypocrisie. Hamid El Mahdaoui ne respecte ni les règles ni l’éthique, encore moins la considération confraternelle. A travers YouTube, il produit de l’indignation à la chaîne, entreprend et entretient du scandale, fabrique des soupçons. Il exploite la confusion entre information, voyeurisme et mercantilisme.
Entre critique indécente et lynchage exacerbé, entre journalisme et tribunal numérique, l’homme pratique une industrie permanente de la diffamation, de la manipulation et de la mise en scène de la colère.
En diffusant illicitement, ce jeudi 20 novembre 2025, des extraits d’une réunion à huis clos tenue plusieurs mois auparavant, de la Commission de déontologie de la Commission provisoire en charge des affaires de la presse, réunion tronquée par un montage orienté, El Mahdaoui n’a cherché ni à informer ni à éclairer l’opinion publique. Il a intentionnellement et de façon malveillante cherché à discréditer, à salir, à semer le doute et à fracturer la confiance dans les institutions de régulation, à l’instar du Conseil national de la presse. Ce n’est pas une démarche professionnelle. C’est une partie de son plan de sabotage moral.
Le plus misérable est que ce comportement n’est ni innocent ni nouveau. Il s’inscrit dans une trajectoire de récidive criarde. Actuellement poursuivi pour diffamation par le ministre de la Justice, condamné à un an et demi de prison ferme et à une lourde amende dans une affaire devant la Cour de cassation, El Mahdaoui traîne derrière lui un passif judiciaire lourd. Pour rappel, il a été condamné à trois ans de prison ferme pour son implication dans l’affaire du Hirak du Rif. Ces faits ne relèvent pas de la persécution politique, mais d’un rapport conflictuel et récurrent avec la loi. Quelle crédibilité alors accorder aux propos et agissements d’un repris de justice ? Nous ne sommes ni face à une condamnation politique, ni devant un acte noble. Il s’agit d’un simple délit de droit commun, sans grandeur ni héroïsme.
Et pourtant, l’homme persiste à se draper dans un voile usé de la “liberté d’expression”, qu’il instrumentalise pour légitimer l’insulte, la diffamation, la manipulation et l’outrage à grande échelle. Or la liberté n’est pas l’anarchie. Elle n’est pas le droit de travestir la vérité, de piéger l’opinion publique ou de jeter l’opprobre sur des personnes, responsables ou simples citoyens, au seul motif de générer du buzz et de l’audience. Et de récupérer une rémunération bien réelle de YouTube, son véritable employeur.
Ce qui se joue ici dépasse le cas El Mahdaoui. C’est le combat entre deux visions du journalisme : celle de la responsabilité, de l’éthique, du respect des règles, et celle du chaos numérique, où l’invective remplace l’information et où la viralité tient lieu de vérité. La Commission provisoire en charge de la presse, en saisissant la justice, trace une ligne rouge salutaire. Elle rappelle que la presse n’est pas une jungle, et que la carte du journalisme ne peut être usurpée par ceux qui n’en respectent ni les principes ni les contraintes, mais qui courent derrière un gain quotidien. Le Maroc n’a pas besoin de faussaires de l’information, ni de gourous du buzz. Il a besoin de journalistes responsables, de professionnels qui mesurent le poids d’un mot, la portée d’une image et la gravité d’une accusation. Bref, une presse mature qui accompagne consciencieusement le développement démocratique du Maroc. Car lorsque la calomnie et le mercantilisme deviennent un modèle, c’est cette démocratie voulue qui vacille. Et lorsque le mensonge se banalise, c’est la vérité qui devient une victime collatérale.
Face à cette dérive, je me permets de rappeler à Hamid El Mahdaoui qu’il n’y a pas de neutralité possible ou absolue. Il y a un choix : celui de défendre la presse ou laisser prospérer sa caricature.
![]()