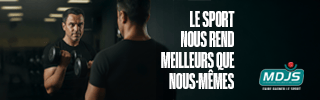À l’orée de chaque échéance internationale majeure, une dramaturgie bien rodée se remet en marche. Elle mobilise un lexique de l’indignation, convoque des figures victimaires soigneusement sélectionnées, et érige l’accusation en vérité première. Le Maroc, une fois encore, se retrouve pris dans cette mécanique où l’émotion tient lieu d’enquête et où la suspicion précède toute analyse.
Le journal britannique The Guardian a récemment diffusé un article affirmant des détentions arbitraires et des violences horrifiques à l’encontre de jeunes manifestants au Maroc. Il ne s’agit pas d’un travail journalistique au sens rigoureux du terme, mais d’un récit à charge où le verdict est prononcé avant l’instruction, et où l’État est présenté comme coupable par essence, sans bénéficier des garanties élémentaires du contradictoire.
La violence des mots comme prémisse de la culpabilité
Le choix lexical employé dans l’article n’a rien d’anodin. Les termes tels que répression, torture ou arrestations arbitraires ne sont jamais démontrés, encore moins juridiquement étayés. Ils fonctionnent comme des signaux émotionnels, destinés à installer une culpabilité immédiate dans l’esprit du lecteur, sans passer par l’épreuve de la preuve. Cette inflation de qualificatifs masque l’absence de faits vérifiables et détourne l’attention des éléments matériels et des procédures légales.
L’illusion d’un soulèvement générationnel
La construction artificielle d’une entité baptisée Gen Z 212 relève davantage de la fabrique symbolique que de l’analyse sociopolitique. Aucun mouvement structuré, aucune revendication clairement formulée, aucune instance représentative identifiable. Pourtant, l’article s’emploie à hisser des protestations hétérogènes au rang de soulèvement historique, comparant abusivement la situation à celle du printemps arabe de 2011. Cette analogie spectaculaire, bien que frappante, est intellectuellement infondée et sert à dramatiser la situation.
Des chiffres orphelins de toute rigueur méthodologique
Le Guardian avance des chiffres massifs : milliers d’arrestations, centaines de détenus, plus de 2400 poursuites. Mais aucune méthodologie précise ni source indépendante n’accompagne ces données. Les éléments judiciaires, le déroulement des procédures et les décisions de justice sont largement évacués, laissant le récit flotter dans une généralisation alarmante. Le droit, au lieu d’éclairer, disparaît du récit, car il contredit la narration choisie.
L’émotion érigée en méthode
Mères endeuillées, corps meurtris, témoignages anonymes : l’article mise presque exclusivement sur l’émotion. Or l’émotion, si légitime soit-elle, ne constitue ni preuve ni enquête. Elle permet de contourner le questionnement essentiel : ces manifestations étaient-elles toujours pacifiques ? Des biens publics ont-ils été attaqués ? Des agents ont-ils été pris pour cible ? Le silence sur ces points révèle un parti pris éditorial assumé.
Une temporalité qui interroge
Il est difficile d’ignorer que la publication coïncide avec l’organisation par le Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations. Cette synchronisation n’est pas anodine. Elle s’inscrit dans une logique de pression symbolique et médiatique, où l’image du pays est mise en tension au moment même où il est sous les projecteurs internationaux. Les droits humains sont convoqués non comme exigence universelle, mais comme levier circonstanciel.
Réhabiliter l’exigence de vérité
Dénoncer des abus avérés est nécessaire et légitime. Mais fabriquer un récit manichéen dans lequel l’État est intrinsèquement coupable et les manifestants toujours innocents est une dérive. Ce type de narration ne sert ni la justice, ni la crédibilité des droits humains, ni l’éthique journalistique. À force de transformer chaque procédure judiciaire en persécution, chaque enquête en répression, et chaque tension sociale en insurrection mythifiée, on ne documente plus la réalité : on la travestit. Et c’est précisément dans cette substitution du récit au réel que se loge la plus grave des dérives.
![]()