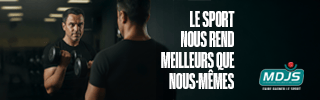Abdelkader Amara, président du Conseil économique, social et environnemental, a révélé le grand déséquilibre dans la répartition des investissements au sein du secteur agricole. En effet, l’agriculture familiale, qui représente 70 % de l’ensemble des exploitations agricoles au Maroc, n’a bénéficié que de 14,5 milliards de dirhams, contre 99 milliards de dirhams alloués à l’agriculture à forte valeur ajoutée.
Amara a souligné, lors d’une rencontre de communication organisée mercredi pour présenter les conclusions du Conseil sur le thème de « l’agriculture familiale petite et moyenne », que ce mode de culture, connu également sous le nom d’agriculture de subsistance ou sociale et solidaire, joue un rôle clé dans le développement rural. Cependant, il souffre d’une marginalisation manifeste au niveau du soutien institutionnel, que ce soit en matière d’accompagnement technique, de financement ou de formation.
Le Conseil a détaillé dans son avis que ces exploitations, bien qu’elles représentent environ 70 % du total des unités agricoles et emploient la moitié de la main-d’œuvre rurale, restent en marge des grands programmes de développement agricole, ce qui accroît leur précarité, notamment face aux changements climatiques, à l’augmentation des coûts de production, aux infrastructures faibles et à l’absence de mécanismes de valorisation.
Amara a critiqué cette disparité flagrante, citant le Plan Maroc vert, qui a concentré des investissements massifs dans l’agriculture d’exportation et à forte valeur ajoutée, tout en négligeant l’agriculture familiale pratiquée sur des terres de moins de trois hectares.
Il a également présenté les résultats de la consultation citoyenne lancée via la plateforme « Je participe », qui a vu une forte participation des habitants des zones rurales, atteignant 57 %. Les résultats ont révélé que les principaux défis auxquels fait face l’agriculture familiale petite et moyenne comprennent la faiblesse de l’accompagnement agricole (27 %), la vulnérabilité des infrastructures face aux changements climatiques (20 %), l’organisation insuffisante (16 %) et les difficultés d’accès au financement (14,5 %).
Amara a insisté sur le fait que l’absence d’organisation au sein des coopératives ou des groupes économiques limite la capacité de ces unités à négocier et à commercialiser, les rendant vulnérables aux spéculations des intermédiaires, notamment sur les marchés hebdomadaires qui constituent le principal débouché pour la vente des surplus de production.
Face à cette réalité, le Conseil a appelé à l’établissement d’un plan d’action national spécifique pour l’agriculture familiale petite et moyenne, prenant en compte les spécificités environnementales et territoriales, et axé sur l’intégration de ce mode de culture dans les chaînes de valeur, la facilitation de l’accès au financement et la valorisation de son rôle dans la préservation de l’environnement.
Le Conseil a proposé une série de recommandations, parmi lesquelles : renforcer les pratiques agricoles durables telles que le semis direct et la rotation des cultures, encourager les cultures résistantes aux changements climatiques comme le figuier de Barbarie, le safran et l’argan, soutenir l’organisation en coopératives, développer des unités industrielles locales pour la valorisation de la production et améliorer les infrastructures dans les zones rurales.
Il a également recommandé de renforcer les services de conseil agricole et d’élargir le soutien pour inclure des activités non agricoles génératrices de revenus, en reconnaissant le rôle environnemental de l’agriculture familiale à travers des mécanismes financiers incitatifs, contribuant à la préservation des sols, à la lutte contre la désertification et à la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel.
Amara a conclu en affirmant que le véritable défi réside dans le passage d’une logique d' »agriculture de subsistance » à un modèle productif intégré, durable et inclusif, qui stabilise les populations rurales, préserve leur dignité et assure la souveraineté alimentaire du Maroc.
![]()