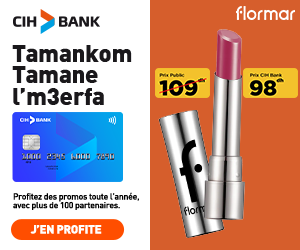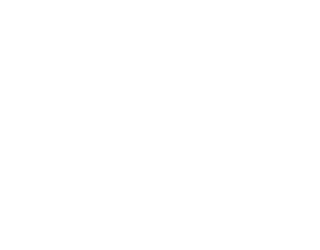Les pays d’Asie du Sud-Est s’orientent vers un changement des équilibres du commerce agricole mondial, en intensifiant leurs accords pour augmenter leurs importations de blé, de maïs et de soja américains. Des pays comme l’Indonésie, le Bangladesh et le Vietnam commencent à renforcer leurs achats auprès des États-Unis, ce qui menace les parts de marché traditionnelles de fournisseurs historiques tels que l’Australie, le Canada, l’Argentine et la Russie.
Au cours de la dernière décennie, les agriculteurs de la mer Noire (Russie et Ukraine) et d’Amérique du Sud ont réussi à capter une part du marché asiatique au détriment des États-Unis. En effet, l’Indonésie, le plus grand importateur de blé au monde, s’est fortement appuyée sur l’Ukraine, la Russie et l’Argentine. Cependant, cette tendance commence à s’inverser. Grâce à des accords commerciaux et à des prix compétitifs, les États-Unis reprennent leur place. Depuis juillet, les meuniers indonésiens ont acheté 250 000 tonnes de blé américain, avec un engagement d’importation pouvant atteindre jusqu’à un million de tonnes par an.
Le Bangladesh suit également cette voie. En juillet, Dacca a approuvé l’importation de 220 000 tonnes de blé américain, avec un accord pour l’avenir pouvant atteindre 700 000 tonnes annuellement, alors qu’elle n’avait pratiquement rien importé des États-Unis en 2024.
Une bataille de prix
L’outil principal de Washington aujourd’hui est le prix. Le blé américain tendre est offert à environ 280 dollars la tonne, soit au même niveau que les prix de la mer Noire. De plus, le maïs américain est moins cher de 10 à 15 dollars par rapport à celui d’Amérique du Sud, tandis que le tourteau de soja américain est vendu cinq dollars de moins que ses concurrents.
Bien que ces différences soient minimes, elles sont cruciales pour des pays cherchant à sécuriser d’importantes quantités de nourriture à moindre coût pour alimenter leur population croissante. L’Asie, en tant qu’importateur net de denrées alimentaires, représente environ 30 % des achats mondiaux de blé, de maïs et de tourteau de soja.
Accords successifs
Après l’Indonésie et le Bangladesh, le Vietnam se met également en mouvement, ayant annoncé en juin son intention de signer des contrats d’une valeur de deux milliards de dollars avec les États-Unis, dont 800 millions de dollars juste avec l’État de l’Iowa pour l’importation de maïs, de blé et d’autres produits dérivés. Ses achats de maïs américain pour la saison 2024/2025 augmentent à 1,1 million de tonnes, contre seulement 2000 tonnes à la même période l’année précédente.
Les Philippines et la Thaïlande préparent aussi le renforcement de leurs importations de maïs américain. Bangkok a indiqué qu’elle importerait deux millions de tonnes de soja dans le cadre d’un nouvel accord, tandis que Manille discute d’une réduction des droits de douane sur le maïs pour diversifier ses sources.
L’Australie et la mer Noire sous pression
Cette évolution constitue une menace directe pour les fournisseurs traditionnels. L’Australie, qui a fourni trois millions de tonnes de blé à l’Indonésie en 2024 (un quart de ses besoins), pourrait perdre des centaines de milliers de tonnes de sa part de marché. Quant aux agriculteurs de la mer Noire, confrontés aux coûts de transport élevés en raison de la distance, ils pourraient subir encore plus la concurrence américaine.
Réajustement des flux mondiaux
Ce changement reflète une tendance stable : face aux tensions géopolitiques et à la nécessité pour les pays de sécuriser leurs approvisionnements, les États-Unis combinent l’arme des prix et la diplomatie commerciale. Si les pays asiatiques respectent ces accords, la carte du commerce mondial des céréales pourrait être redessinée : davantage de céréales américaines vers l’Asie, entraînant un repositionnement forcé de l’Australie, de l’Argentine, de la Russie et du Canada.
Timothy Lo, directeur régional du Conseil des exportations de soja américain pour l’Asie du Sud-Est et l’Océanie, estime que ces accords offrent à Washington une opportunité de consolider sa présence sur les marchés asiatiques à long terme.
Alors que les dernières années ont vu une diminution de la position des États-Unis face à leurs concurrents de l’hémisphère sud et de la mer Noire, l’Asie leur offre aujourd’hui une chance de redressement imprévu. La bataille pour le blé, le maïs et le soja ne se jouera pas uniquement sur les volumes, mais également sur la capacité à établir des partenariats stratégiques garantissant une place stable dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale.
![]()